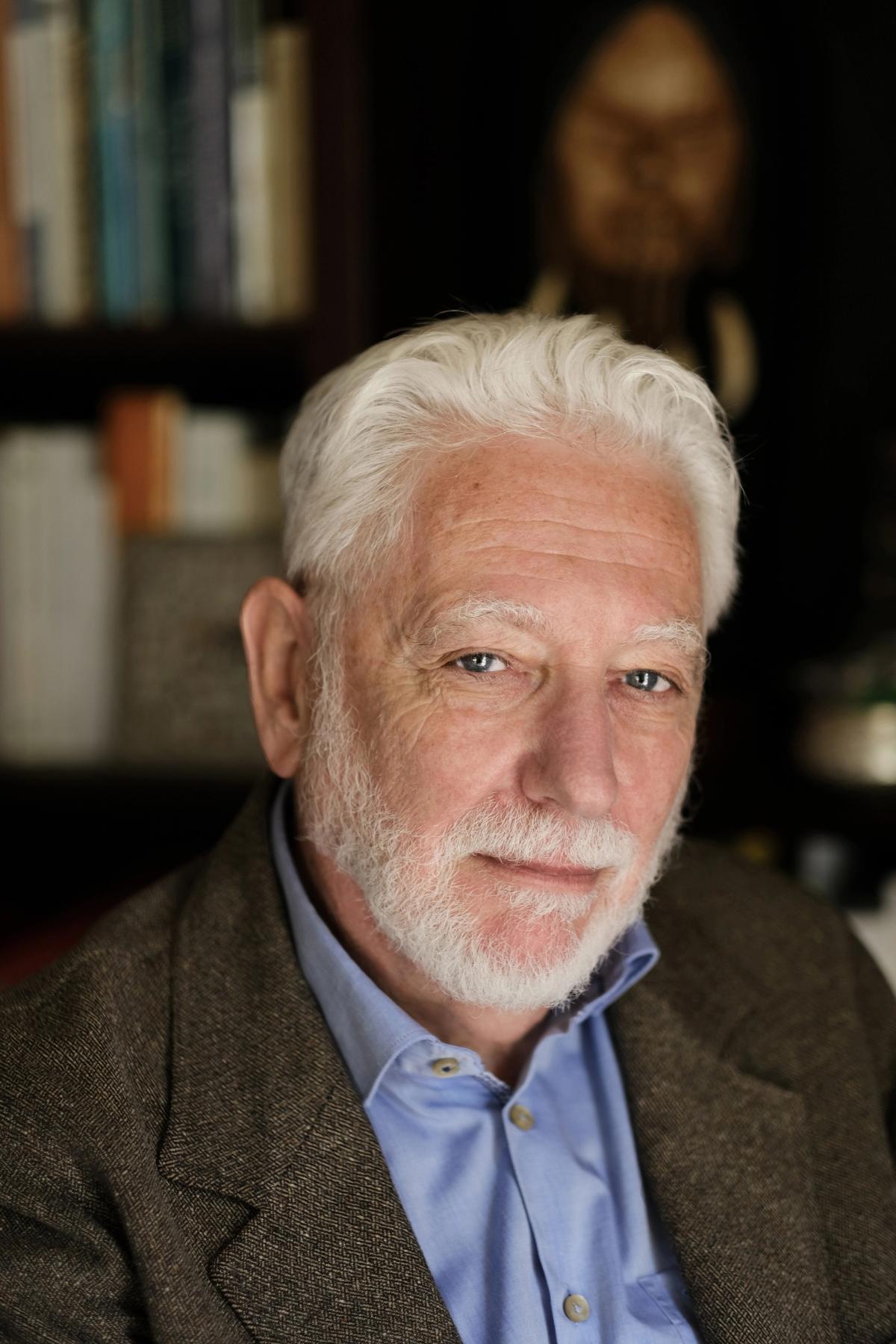Dans l’avant-propos des « Formes du visible », vous notez que les outils intellectuels des sciences sociales, dans la continuité de la philosophie des Lumières, ne correspondaient pas aux observations de terrain sur les rapports entre humains et non-humains. Fort de ce constat, vous avez cherché à « mettre en lumière ce que l’on pourrait appeler des formes de “mondiation” ». Qu’entendez-vous par là ?
En vivant avec les Achuar en Amazonie, j’ai effectivement constaté que ces outils de compréhension sont inadéquats. L’un des objectifs à mon retour a été de les réformer. Le premier, c’est la distinction entre nature et culture, qui n’a aucun sens dans la population où j’ai séjourné. Au fil de mes recherches, à partir de l’ethnographie et des données publiées sur d’autres populations, j’ai découvert que ce partage n’a de sens que dans très peu de situations, existant essentiellement en Europe et dans les langues européennes. Aussi ai-je voulu proposer une lecture alternative, avec les formes de « mondiation », autrement dit des façons de composer des mondes en détectant dans les éléments qui environnent les humains des continuités et des discontinuités qui ne passent pas toutes par les mêmes frontières que les nôtres. Il n’y a pas, d’un côté, les humains dotés d’une intériorité, d’un esprit, d’une capacité à symboliser et, de l’autre, des non-humains qui en seraient dépourvus.
Vous distinguez quatre systèmes de qualités que l’on peut détecter dans les êtres et les choses : l’animisme, le totémisme, l’analogisme et le naturalisme. À quoi correspond chacun ?
Ces systèmes de qualités sont tous fondés sur un double contraste : présence ou absence chez un autrui quelconque d’une intériorité ou d’une extériorité semblable à la mienne. Dans le naturalisme, les humains sont les seuls à disposer de cette intériorité, mais sont rattachés aux non-humains par leurs dispositions physiques. À l’inverse, l’animisme consiste à considérer que l’on peut détecter chez tous les êtres – enfermés dans des mondes singuliers, qui leur sont propres du fait de leurs dispositions physiques – des intentions, des manifestations d’une volonté autonome. Dans certains cas, on peut communiquer avec eux dans les rêves… Le second groupe de contrastes opère entre l’analogisme et le totémisme. Dans ce dernier cas, des groupes d’humains à l’intérieur d’une classe nommée partagent des dispositions physiques et morales. Autrement dit, ce ne sont pas les différences de formes qui comptent, mais des ressemblances plus abstraites. Ces êtres se distinguent en bloc, à l’intérieur d’une classe totémique, d’autres humains et non-humains appartenant à d’autres classes totémiques. La dernière forme de mondiation, l’analogisme, est fondée sur la pensée analogique, qui consiste à trouver des réseaux de correspondance entre des singularités. Elle est commune à bien des régions du monde, y compris en Europe jusqu’à la Renaissance.
En vous « apportant la révélation que d’autres mondes pouvaient se déployer en marge de celui dans lequel [vous aviez] pris [vos] aises, l’animisme a déclenché l’enquête dont ce livre est une étape ». En quoi a-t-il été un déclencheur ?
J’étais intrigué par un caractère énigmatique des collectifs amazoniens que les chroniqueurs ont commencé à mettre en exergue dès le XVIe siècle et qui s’est perpétué dans les travaux des anthropologues. Ces collectifs n’avaient pas d’institution repérable analogue aux nôtres, ils semblaient vivre dans une sorte d’anarchie belliqueuse et, dans le même temps, se distinguer à peine de la nature. Selon mon intuition, quelque chose dans leur rapport à la nature pouvait peut-être expliquer cette absence d’institutions repérables. J’ai découvert que la vie sociale y était considérablement élargie, puisqu’elle intégrait en son sein des partenaires sociaux non humains. Dès lors, la distinction entre nature et culture n’a guère de sens pour définir ces populations, ce dont j’ai rendu compte par la suite dans l’essai intitulé Par-delà nature et culture (2005). La découverte de formes de relation au monde différentes de la nôtre m’a conduit à cette série d’enquêtes menées au fil des décennies pour aboutir à ce livre, Les Formes du visible.
Vous partez du constat que les concepts au moyen desquels nous pensons la cosmologie moderne sont récents et sans pertinence pour rendre compte de civilisations régies par des frontières différentes entre humains et non-humains. Cet ouvrage est une étape, écrivez-vous. Quelle en sera la suite ?
Ce travail sur les images résulte de plusieurs années de cours donnés au Collège de France. Je m’intéresse aujourd’hui au paysage, à la façon dont des sociétés qui ne sont pas paysagères au sens traditionnel du terme – sans représentation figurative ni discours – produisent néanmoins des transfigurations de sites, de lieux, de telle façon qu’ils deviennent des signes d’autre chose qu’eux-mêmes. C’est le sujet de mon prochain livre, moins systématique que le précédent, mais toujours dans l’idée d’introduire du pluralisme ontologique dans l’étude de phénomènes traditionnellement considérés soit comme propres au monde occidental, soit universalisables. Il me semble qu’il faut chercher entre les deux des réalisations concrètes – c’est le cas pour le paysage.
Votre livre pose les bases d’une anthropologie de la figuration à travers une étude comparative des images produites par l’homme. En quoi et pourquoi représente-t-on différemment selon les cultures, les régions, les époques ?
Parce que, précisément, les modes de mondiation diffèrent. Le système perceptif humain est commun à tous mais, en fonction des dispositions culturelles, nous détectons ou non dans le monde qui nous entoure certaines choses, auxquelles nous accordons plus ou moins d’importance. Un chasseur animiste sera sensible à des traces, des indices qu’il a appris à détecter depuis l’enfance dans les récits de ses parents, qu’il va interpréter en forêt et associer à la présence d’un animal ou d’un esprit. Selon les cultures, les systèmes de détection sont différents, par habitude de détecter des choses et d’en ignorer d’autres. Les images nous révèlent cela : chaque forme de mondiation résulte en des images qui sont pertinentes ou non pour le collectif.
Cette question était au coeur de votre exposition « La Fabrique des images » au musée du quai Branly, à Paris (février 2010-juillet 2011). Léonard de Vinci qualifiait ainsi la peinture de « cosa mentale » – une « vue de l’esprit ». La figuration n’est pas une imitation du réel mais un moyen de rendre perceptible. Une image traduit avant tout une vision du monde. Cependant, vous dites « être dans un premier temps tombé dans un travers auquel les historiens de l’art n’échappent pas toujours, traiter les représentations imagées comme des illustrations de systèmes symboliques et discursifs qui les justifient et les rendent compréhensibles ». Cette lecture vous semble-t-elle limiter le champ des interprétations possibles ?
Utiliser le discours est nécessaire à partir du moment où il existe des documents qui permettent d’éclairer les images – c’est du reste ce que j’ai fait dans ce livre. Je n’ai pas parlé d’images sur lesquelles je n’avais aucune information quant aux conditions de production et d’usage. C’est à peine si j’évoque l’art paléolithique, les grottes ornées. Ce recours au langage est indispensable, mais n’est pas suffisant. J’ai beaucoup appris de la fréquentation de l’œuvre de Daniel Arasse : il ne s’agit pas simplement de savoir ce qu’une image représente en fonction de ce que les historiens ou les contemporains ont pu en dire, mais de voir littéralement ce qu’elle montre, ou ne montre pas. Je pense que c’est très important. Il faut donc une certaine naïveté dans le regard, fondée sur l’intérêt que les anthropologues éprouvent pour la comparaison.
En quoi votre regard d’anthropologue diffère-t-il de celui d’un historien d’art ?
Un historien d’art met en contraste les images dont il s’occupe à l’intérieur d’un champ relativement limité (celui de l’art européen, du baroque, du surréalisme…) avec des transitions, des héritages, des influences. Ma démarche, et celle des quelques anthropologues qui s’intéressent à la question des images de façon comparative, est de contraster des images dans des zones de production extrêmement variées et sans contacts entre elles. Ce ne sont pas les ressemblances qui m’importent, mais la façon dont les différences forment système.
Si le naturalisme européen naît au XVIIe siècle, distinguant dès lors les humains des non-humains par leur esprit et non plus leur corps – le fameux « cogito » cartésien –, vous notez que cette nouvelle conception du monde a commencé à transparaître dans les représentations iconiques bien avant. Sous quelle forme ?
Pour moi, ce bouleversement naît véritablement avec les Primitifs flamands. J’insiste tout particulièrement sur le fait que les transformations dans les façons de faire monde sont visibles dans les images. La nature discursive de ces transformations suit cette période de bouillonnement où, en quelques décennies, au début du XVe siècle, un monde nouveau apparaît dans les enluminures, les tableaux. Avec des répercussions à long terme, sur deux siècles. C’est aussi ce qui s’est passé avec la révolution cubiste, qui a engendré de très nombreuses hybridations, une grande diversité de manières de montrer des formes de mondiation alternative dans les images, et qui annonce une forme de mondiation dont nous n’avons pas encore tiré toutes les conséquences sur le plan conceptuel et philosophique. Le naturalisme comme constitution de la modernité est en train de s’effriter sous nos yeux. Les philosophes, les sociologues, les anthropologues contribuent à réfléchir à ce que cela signifie en termes de transition vers autre chose.
Vous saluez un changement de regard, depuis la fin du XXe siècle, chez certains historiens d’art qui examinent la puissance évocatrice des images, leur rôle dans la vie sociale, au-delà de l’approche sémiotique, de l’analyse des signes de la théorie de l’art. Vous référant notamment au livre « Art and Agency » d’Alfred Gell (1998), vous reprenez à votre compte le terme « agence », de l’anglais « agency ». De quoi s’agit-il ?
Ce terme, très commun chez les philosophes anglais depuis le début du XVIIIe siècle, a aussi été traduit en français par « puissance d’agir ». Le terme « agence » me semblait parfaitement approprié pour traduire l’idée selon laquelle les images sont des agents qui déclenchent en nous des réactions nous induisant à leur reconnaître une forme d’autonomie, une existence qui leur est propre et singulière. Grâce à Alfred Gell et d’autres auteurs, il est devenu plus admis que les images exercent sur nous une « agence » et qu’il faut pouvoir les analyser non seulement en interprétant les symboles dont elles sont truffées mais aussi le type d’action qu’elles produisent sur nous. L’un des arguments du livre est que ces formes d’actions ne sont pas universelles, mais liées à l’un des quatre régimes figuratifs que j’essaye de mettre en évidence.
L’art moderne et contemporain a beaucoup puisé dans les modes de représentation traditionnels pour se renouveler. Pablo Picasso était fasciné par la statuaire africaine. Vous citez dans votre livre l’influence sur Jackson Pollock des expositions d’art amérindien au Museum of Modern Art, à New York, ou encore la dimension chamanique de la performance « I Like America and America Likes Me » de Joseph Beuys avec un coyote… Y voyez-vous une manière de s’approprier ce pouvoir magique des images, des effigies, pour revenir à une sorte d’essence première, primitive de l’art ?
Il est difficile de répondre de façon générale, car chaque artiste a puisé des stimulations dans certains aspects des images auxquelles il avait accès. Mais, globalement, je ne pense pas qu’il s’agisse d’autre chose que d’une stimulation. À ce propos, je cite des remarques de Pablo Picasso ou André Derain qui ne laissent aucun doute sur ce qu’ils pensent : au fond, c’est en eux que ce qu’ils ont fait a pris source. Simplement, ils ont vu dans les fétiches africains, les masques océaniens la possibilité de faire quelque chose qu’ils portaient déjà en eux, mais n’avaient pas actualisé. Ils ne savaient à peu près rien de « l’art primitif », ne connaissaient pas les travaux anthropologiques y ayant trait. Même lorsque Max Ernst s’installe en Arizona, il ne sait pas grand-chose sur les Hopis. La découverte de ces cultures a induit les artistes à puiser en eux des intuitions, des inférences qui leur permettaient d’atteindre des manières de figurer très différentes de celles auxquelles ils avaient eu accès dans le cadre de leur éducation. Dans Les Demoiselles d’Avignon, ce qui est pour moi plus important que l’influence africaine, c’est l’introduction du polyperspectivisme, le fait que chacune des figures est diffractée selon différents points de vue. L’une des régions du monde où l’on a pratiqué cela avec un brio exceptionnel est la côte nord-ouest du Canada. Or, je ne pense pas que Picasso en avait la moindre idée… Mais, pour la première fois depuis le Moyen Âge, on a montré des êtres sous différents angles d’observation – c’est ce qui est fondamental.
L’histoire de l’art classe les œuvres et les artistes par courants artistiques, en articulant des moments de rupture sous l’effet des avant-gardes. Que vous inspire cette construction au regard de votre analyse des différentes traditions iconographiques ?
Il est indubitable qu’il y ait des traditions iconographiques. Les historiens d’art les étudient dans leur continuité et leur discontinuité. Pensez à l’iconographie égyptienne, qui utilise les mêmes codes pendant trois millénaires. Ce que l’on connaît beaucoup moins, et sur quoi on a peu travaillé, ce sont les conditions dans lesquelles ces traditions changent. Qu’est-ce qu’une avant-garde ailleurs que dans le contexte européen, où il existe une forme d’émulation, de compétition, un marché ? Comment fonctionnent des gens qui bouleversent les codes d’une tradition iconographique en un autre endroit du monde ? On le sait un peu pour les arts d’Extrême-Orient – je pense à un livre de François Cheng sur l’art du paysage « excentrique » en Chine [Toute beauté est singulière. Peintres chinois de la Voie excentrique, Paris, Phébus, 2004] – mais, dans beaucoup de cas, on n’en sait rien.
Où placez-vous l’abstraction, qui a constitué une révolution après des millénaires de figuration. Est-elle exclusivement occidentale et relativement récente ou en trouve-t-on trace dans certaines cultures traditionnelles ?
En vérité, je ne sais pas très bien ce qu’est l’abstraction. Lorsque Paul Klee, Mark Rothko ou Robert Motherwell donnent un titre à l’une de leurs compositions, il me semble qu’il s’agit là d’une façon de pointer vers une iconicité, vers l’idée que la toile figure un moment de vie, une disposition intérieure. Le tableau représente non pas un objet mais un état. L’abstraction existe ailleurs : ce sont des motifs. Je consacre dans mon livre des analyses à l’usage des graphèmes, des motifs de peintures corporelles en Amazonie. Rendre l’image d’un esprit en reproduisant, soit sur un corps humain, soit sur un costume, les graphèmes qui caractérisent la façon dont cet esprit se donne à voir à ses congénères, c’est de l’abstraction ; mais c’est en même temps de la figuration, puisque l’on peut reconnaître l’esprit à travers ces indices abstraits. La question est difficile, car l’éventail de formes d’abstraction est très étendu. Par exemple, les « pièges à penser » de l’art ornemental ne sont pas directement figuratifs, ils ont pour effet de stimuler l’imagination, c’est-à- dire la capacité de figuration intérieure.
Dans les années 1970, le land art a émergé de concert avec une réflexion sur les enjeux écologiques. L’idée de renouer avec la nature nourrit la pensée et la création actuelles. Philosophes et artistes contemporains s’intéressent à la vie des végétaux, essayant de repenser notre rapport au monde. Que vous inspire cette prise de conscience d’une déconnexion avec la nature, le regard tourné vers le modèle des sociétés traditionnelles ?
Pour moi, la nature n’existe pas. C’est un concept, une abstraction. Se rapprocher de la nature, c’est toujours être naturaliste, c’est-à-dire abroger un abîme qui s’est constitué dans le développement du naturalisme entre les humains et les non-humains. Un certain nombre d’artistes contemporains, me semble-t-il, sont encore dans la démarche de retrouver des liens, avec nostalgie. Mon intérêt va davantage vers ceux qui ont complètement sauté le pas et traitent dans leurs images d’un monde où il n’y a plus aucun sens à dissocier les humains des artefacts, des plantes, des domaines physiques, etc. Je pense en particulier à Pierre Huyghe, auquel je m’intéresse depuis quelque temps. J’ai vu récemment son installation After UUmwelt, tout à fait extraordinaire, à la Grande Halle du Parc des ateliers, à Luma Arles. Il crée là un écosystème au sens littéral du terme, c’est-à-dire un ensemble d’interactions entre des machines, des points de vue humains, un dispositif de cellules cancéreuses qui se divisent et activent des productions d’images… ce sont des choses entièrement nouvelles. Il ne s’agit plus de se rapprocher de la nature. Ce genre de nostalgie un peu passéiste confine plutôt au romantisme, comme ça l’a été au XIXe siècle. Je trouve beaucoup plus intéressant de tenter de sortir de la confrontation entre humains et non-humains et de trouver des formes hybrides d’interaction entre les différents éléments du monde.
D’où vient votre intérêt pour les images ?
Je n’ai pas connu mon arrière-grand-père, Étienne Tournès, qui peignait un peu à la manière de Pierre Bonnard et dont on trouve des tableaux dans les musées. Mais je me souviens très bien de sa fille Jeanne, peintre également, et d’avoir eu, enfant, une idée assez précise de ce qu’est un atelier de peintre. Je pense que cela a compté : qu’est-ce que c’est que quelqu’un dont le métier est de faire des images ? Non seulement le résultat, à travers des tableaux de famille, mais aussi le processus de produire ; j’ai baigné très jeune là-dedans, y compris l’odeur de térébenthine. Ma mère était une aquarelliste amateur de talent, je me rappelle être allé lui chercher de l’eau dans une petite rue d’un village des Baléares alors qu’elle peignait un paysage. Moi-même, assez tôt, j’ai pris plaisir à dessiner. Mon goût pour l’histoire de l’art vient sans doute aussi de cette continuité familiale.
Claude Lévi-Strauss, qui fut votre directeur de thèse de doctorat en ethnologie à l’École pratique des hautes études, s’est intéressé à la force plastique, aux codes esthétiques et au langage complexe des masques indiens dans un livre remarquable, « La Voie des masques » (1975). Votre travail s’inscrit-il dans cette continuité ?
Dans la continuité de la perspective de Lévi-Strauss, sans aucun doute, et de textes qu’il a consacrés à la représentation dans Tristes Tropiques ou La Pensée sauvage, par exemple, mais pas en continuité de La Voie des masques. Dans cet ouvrage, il s’efforce de trouver dans la structure des mythes des éléments permettant d’expliquer les caractéristiques de certains masques. Ce que j’ai fait est en quelque sorte plus téméraire. J’ai essayé de mettre ces contrastes en évidence à l’échelle mondiale, et non à celle des savoirs sur une société singulière. Lévi-Strauss a tenté cette généralisation dans son article sur le dédoublement de la représentation sur la côte Nord-Ouest, qu’il interprète comme une caractéristique des sociétés à masques – ce avec quoi je ne suis pas tout à fait d’accord. Mais, d’une manière générale, l’anthropologie ne peut que s’intéresser aux images et, surtout, au processus de figuration. Nous nous sommes beaucoup attachés aux modes de production – les chasseurs-cueilleurs, les pasteurs nomades, les essarteurs… –, des formes d’être au monde fondées sur des techniques d’usage et de manipulation des non-humains, moins à la façon dont ces formes sont figurées. Or, la figuration est un champ d’une extrême fertilité pour comprendre la diversité humaine. De ce point de vue, c’est un domaine prioritaire pour l’anthropologie. De nombreux travaux ont étudié une esthétique locale, sans aller plus loin. C’est ce que j’essaye de faire dans ce livre.
Que diriez-vous à un jeune étudiant qui souhaite se lancer dans l’anthropologie ?
J’en vois constamment, j’ai encore quelques étudiants ! De le faire, bien sûr ! Il n’y a rien de plus beau. C’est une vocation, comme le disait Lévi-Strauss. Les expériences sur le terrain que font les jeunes ethnologues sont magnifiques. On a tendance à penser que les « sociétés primitives » disparaissent, c’est faux. D’abord parce qu’il n’y a pas de « sociétés primitives » – c’est une terminologie absurde –, mais aussi parce qu’elles changent tout le temps. À chaque génération, des caractéristiques singulières naissent au sein d’une société.
-

Philippe Descola, « Les Formes du visible ».
Philippe Descola, Les Formes du visible, Paris, Seuil, « Les Livres du nouveau monde », 2021, 848 pages, 35 euros.