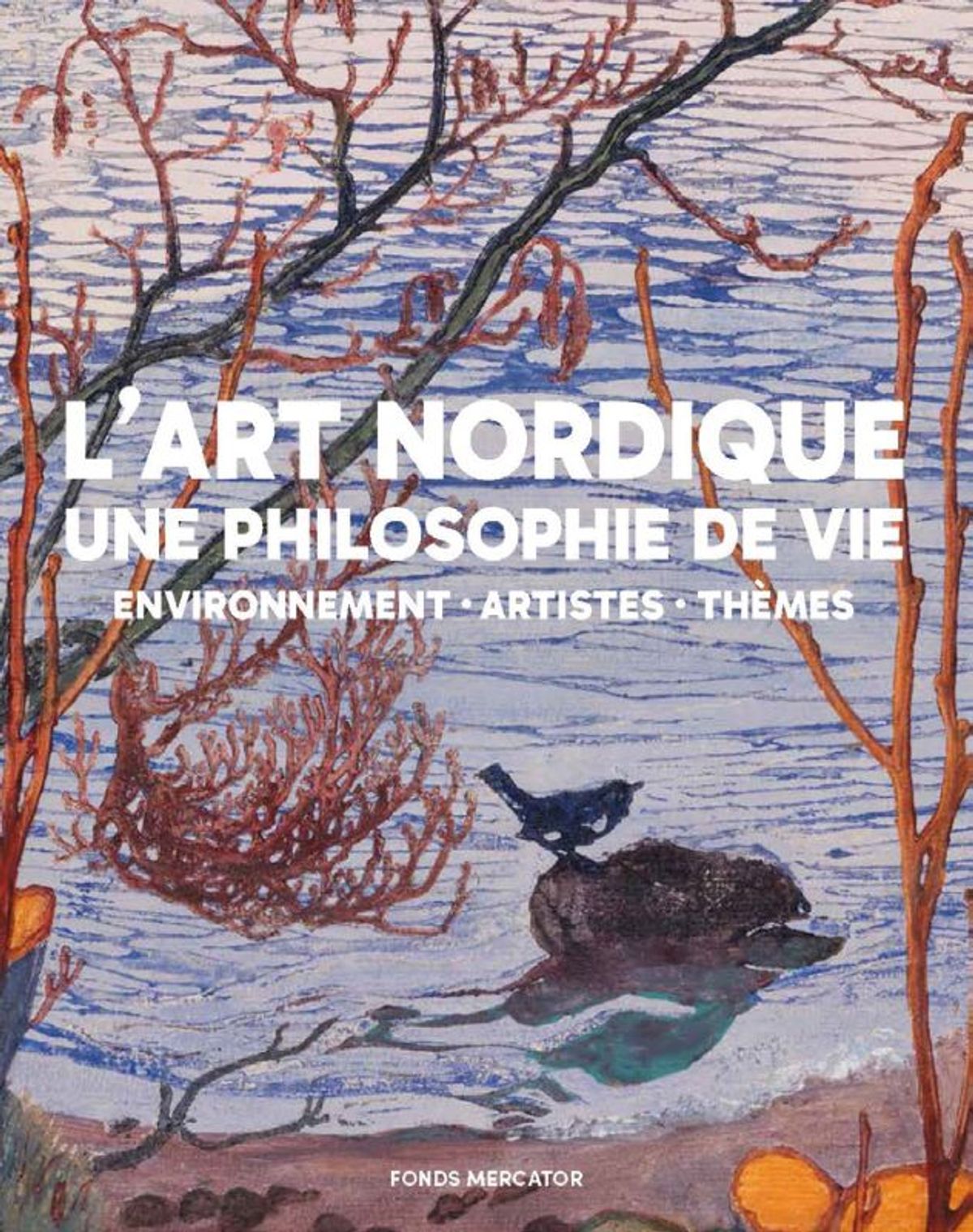Ce n’est pas un hasard si c’est à Paris qu’a été lancée, à la fin 2024, L’Art nordique. Une philosophie de vie. « Il y a un engouement exceptionnel en France pour l’art scandinave actuellement », a souligné Bernard Steyaert, le directeur du Fonds Mercator, éditeur de l’ouvrage, lors de la présentation à l’Institut finlandais. Après la Norvégienne Harriet Backer au musée d’Orsay et le Suédois Bruno Liljefors au Petit Palais en 2024, c’est au tour du Norvégien Christian Krohg d’être à l’affiche du musée d’Orsay à partir du 25 mars 2025.
Aux origines de cette publication, un duo féminin qui a travaillé ensemble à l’Ateneum, le musée des Beaux-Arts d’Helsinki, en Finlande, et assuré le commissariat d’exposition dans le monde entier : Susanna Pettersson (professeure et directrice générale de la Suomen Kulttuurirahasto [Fondation culturelle finlandaise] à Helsinki) et Anna- Maria von Bonsdorff (actuelle directrice de l’Ateneum). « Il manquait une pièce au puzzle, un livre pour contextualiser l’art nordique », expliquent-elles. Comme le précise Anna-Maria von Bonsdorff, le choix s’est porté presque exclusivement sur des auteurs scandinaves « pour avoir un accès prioritaire aux sources primaires ». Si un progrès considérable a été accompli « depuis la fameuse histoire de l’art d’[Ernst] Gombrich, lequel, dans les années 1950, ne mentionnait qu’un seul artiste scandinave, [Edvard] Munch », reprend-elle, bien des aspects restent à étudier. Malgré quelques bémols – l’Islande, qui fait pourtant partie des pays nordiques, n’a pas été incluse ; l’ouvrage se concentre sur la peinture et n’aborde quasiment pas la sculpture, ni d’ailleurs le rôle important de l’illustration –, la publication est une réussite.
UN PANORAMA EXHAUSTIF
L’ouvrage revient d’abord sur la genèse de l’art nordique, étant entendu qu’il se concentre sur un âge d’or dans l’histoire de l’art de cette région, la fin du XIXe siècle et les premières décennies du siècle suivant. C’est ainsi que dans ce premier grand chapitre, Nils Ohlsen aborde le rôle crucial des collectionneurs privés entre 1880 et 1920, de Pontus Fürstenberg à Göteborg à Ernest Thiel à Stockholm, protecteurs d’artistes qui s’émancipent peu à peu des règles un peu figées de l’Académie. Le rôle des collectifs, des voyages et des « colonies » d’artistes tant dans le Nord qu’à l’étranger, et en particulier en Allemagne et en France, est souligné par Marja Lahelma et Alexandra Herlitz dans un deuxième volet consacré aux artistes eux-mêmes. Un troisième chapitre explore des thématiques essentielles comme les stratégies des femmes (dont deux figures de proue, Helene Schjerfbeck et Hilma af Klint) pour percer, sous la plume de Carina Rech, mais aussi la place du corps nu dans l’imaginaire et ses liens avec la nature (Patrik Steorn). Un quatrième chapitre détaille les six grands thèmes de la peinture scandinave, dont la nature, la vie quotidienne, la vie familiale, mais également les mythes et légendes (et notamment le Kalevala, l’épopée finlandaise), aspect fondamental dans l’art nordique, qui contribue à le distinguer de la production artistique du reste de l’Europe à la même époque. Dans un chapitre conclusif, les deux directrices de la somme abordent une problématique à venir : comment le regard sur cette région change-t-il au fil des expositions dans le monde ? « L’étape suivante consiste à inclure dans cette reconnaissance des artistes moins connus, mais tout aussi intéressants », soulignent-elles.
Susanna Pettersson et Anna-Maria von Bonsdorff (dir.), L’Art nordique. Une philosophie de vie. Environnement, artistes, thèmes, Bruxelles, Fonds Mercator, 320 pages, 65 euros.