Comment êtes-vous devenu artiste ?
Je suis né en Corse [en 1952] dans un petit village. Durant toute mon enfance, mes compagnons de jeu étaient les éléments de la nature. Être entouré par la mer, avec son mouvement perpétuel, ses tempêtes, les couchers de soleil, a forgé en moi une réceptivité aux éléments. Le fait d’être souvent solitaire a sûrement développé chez moi une sensibilité, une introspection, le désir d’une certaine profondeur poétique…
Vos études, très tôt tournées vers les arts plastiques, ont sans doute également joué un rôle…
J’ai eu la chance de faire ma scolarité dans un lycée qui expérimentait le baccalauréat artistique. En tant que « cobayes », il nous a vraiment été donné les moyens de travailler. Chaque sujet devait être traité sous toutes les formes : dessin, peinture, sculpture, mais aussi film, photographie, son ou même performance. C’était aux alentours de 1968, et il ne faut pas oublier que, durant ses années, les cartes des possibles étaient rebattues, les cloisons s’effondraient. J’ai pu profiter de cet élan.
À Paris, vous embrassez le cinéma expérimental.
Quand je suis arrivé au département des arts plastiques de l’université de la Sorbonne, j’ai choisi la section cinéma expérimental, alors dirigée par Dominique Noguez. Ce dernier invitait des personnalités telles que Kenneth Anger ou Jonas Mekas. On regardait des films d’Andy Warhol. C’était un moment très important du cinéma expérimental, et je m’y suis engouffré. Dans les années 1970, Roland Barthes, Jacques Lacan et Michel Foucault sont à leur apogée. J’avais des professeurs comme Michel Journiac, lequel faisait des messes avec son propre sang. Tout ce contexte a contribué à faire de moi celui que je suis aujourd’hui.
Pourquoi cet attrait pour l’image en mouvement ?
J’étais très marqué par la génération B.M.P.T. [Daniel Buren, Olivier Mosset, Michel Parmentier et Niele Toroni]. À présent, j’aurais peut-être un autre avis, mais, à l’époque, Daniel Buren ne faisait plus que des rayures; d’une certaine façon, la peinture était morte. Je trouvais le territoire du cinéma bien plus créatif, qu’il soit expérimental ou commercial, avec des réalisateurs comme Michelangelo Antonioni, Pier Paolo Pasolini, Jean-Luc Godard.
Vous faites partie des pionniers de l’art vidéo dans les années1970. Quel est votre regard sur son évolution ?
À une époque où tout un chacun possède un outil de fabrication d’image et de film dans sa poche, il est important que l’artiste prenne en main ce médium et ne le laisse pas aux pouvoirs médiatiques. Il faut insuffler à ce territoire une éthique poétique et philosophique, dont seul l’artiste est capable.
La vidéo n’a jamais été une limite pour vous.
Je voudrais ne surtout pas être mis dans une case. Je travaille bien sûr beaucoup avec la vidéo, mais je ne suis pas que vidéaste ou cinéaste. Lorsque je prépare une exposition, comme ma rétrospective au Frac Corsica*1 l’été dernier, je mélange toutes sortes de pièces. Tout est lié, et ma position en tant qu’artiste n’est pas limitée à une technologie. Il y a évidemment des technologies qui, momentanément, me correspondent mieux, pour des raisons écologiques par exemple, ou bien parce que j’estime que certains supports ne doivent pas être laissés entre de mauvaises mains.
La manière dont les motifs défilent dans vos œuvres évoque les émotions et les pensées qui animent la conscience humaine. Quelle place tient l’humain dans votre œuvre ?
L’humain a toujours été au cœur de mon œuvre, car il est son premier spectateur. Par son regard, il la révèle et lui permet d’exister. Que ce soit un poème adressé à un être aimé ou une œuvre pour un public, c’est pour l’autre que tout artiste crée. Cet « autre » dont je parle peut aussi être politique : on peut vivre et créer dans le but de changer le monde.
Vous entretenez un rapport particulier à la nature, sur laquelle vous posez un regard sensible et contemplatif. Un éveil écologique s’est-il opéré dans votre travail ?
De manière inconsciente peut-être. J’ai réalisé un certain nombre de vidéos sur la nature. J’étais intéressé par ses matières, les feuillages d’arbres bougeant dans le vent par exemple. Je voulais montrer cette communauté pleine de vie. À l’époque, je n’avais pas l’impression de faire un geste écologique, c’est plutôt que je considère l’élément naturel comme un être vivant, un être de dialogue. Aujourd’hui, en revanche, j’essaie de faire attention, de faire en sorte que mes installations ne soient pas trop énergivores.

Vue de l’exposition « Ange Leccia. Au film du temps », musée des Impressionnismes, Giverny, 2022. © Musée des Impressionnismes, Giverny
Votre œuvre vidéo La Mer (1991), qui montre les flux et reflux des vagues montés à l’envers, a beaucoup marqué. De sa simplicité se dégage une grande puissance. Cet équilibre de forces contraires se retrouve souvent dans votre travail.
Cette succession de vagues, qui ne sont jamais les mêmes, m’évoque un être humain arrivant sur terre pour ensuite en disparaître avec cette apparente continuité. C’est une manière symbolique de raconter la vie. Je fais également un parallèle avec l’art qui, loin d’être quelque chose de figé, se réinvente en continu. Dans l’art, les mouvements et les générations se succèdent, mais il existe toujours un lien. Quant aux forces contraires, elles sont aussi complémentaires. Il est important d’être dans la retenue, car l’explosion amène à la destruction. Du reste, la simplicité permet de laisser une part de liberté au spectateur : il développe lui-même une histoire à partir d’une chose simple que je donne à voir.
Dans les années1980, vous imaginez ce que vous appelez des « arrangements ».
Mes arrangements sont une tentative de regarder autrement des objets du quotidien, de leur donner un sens nouveau et de faire œuvre avec eux – ce que Marcel Duchamp avait déjà bien fait avant moi. Si l’on regarde ma pièce Le Baiser (1985) par exemple… habituellement, un projecteur éclaire une situation. Lorsque j’en mets deux face à face, la lumière n’a pas le temps d’aller à l’extérieur, elle est réabsorbée par le projecteur qui lui fait face. Il y a presque une idée de philosophie zen : l’intériorité avant le « faire ». Il y a aussi toujours cette idée de rencontre, de l’importance de l’autre sans lequel mon œuvre n’existerait pas.
Lorsque vous filmez des musées, êtes-vous également dans cette optique de déplacement de sens ?
J’aime bousculer et décadenasser ces lieux figés dans le passé. L’artiste, lorsqu’il « investit » le musée, le regarde avec un œil contemporain. Le musée devient un matériau de création qu’il se réapproprie et réinvente. C’est ce que j’entreprends dans mes films La Déraison du Louvre (2006) ou Antoine Bourdelle (2009).
Aujourd’hui, vous filmez moins et menez un travail de réinterprétation de vos archives.
Ayant filmé depuis les années1970, j’ai en effet beaucoup d’archives. Utiliser un rush du début des années 1980 ou 1990 pour faire quelque chose de contemporain m’intéresse beaucoup. Le statut des images dépend de ce que l’on en fait. Ce n’est pas parce que je vais filmer une image en 2023 qu’elle sera plus « d’aujourd’hui » qu’une image tirée d’une vidéo de 1981.
En 1981, vous devenez pensionnaire de la Villa Médicis, à Rome. Comment cette étape a-t-elle influencé votre œuvre ?
La Villa Médicis m’a obligé à me battre dans un contexte que je n’avais pas choisi. Dans les années 1970, j’ai quitté la Corse pour m’émanciper. Je suis arrivé à Paris, où je vivais dans un monde underground, nocturne et expérimental. J’aurais préféré aller à New York. Lorsque je me suis rendu à la Villa Médicis où j’ai été nommé, j’y ai retrouvé tout ce que j’avais eu envie de quitter : le soleil, le calme méditerranéen, la provincialité. Il y a aussi cette présence très forte du passé. J’ai dû me réinventer pour pouvoir faire œuvre avec Rome et cet univers gréco-romain. La caméra vidéo m’a beaucoup aidé. Je trafiquais et détériorais ses images. J’ai pu transformer le réel en une matière qui donnait une forme de couche à ce que je regardais. Cela m’a permis de « déculpabiliser mon dialogue » avec cet univers.
Dix ans plus tard, vous êtes l’un des premiers artistes en résidence à la Villa Kujoyama, à Kyoto; cette expérience marque un tournant dans votre parcours.
Au Japon, j’ai acquis une nouvelle conscience de la nature qui m’entourait, laquelle, dans la culture shinto, est considérée comme un élément divin. Je me souviens avoir observé des amis japonais fermer les yeux ou baisser la tête devant un arbre ou une montagne. J’ai compris que la nature y avait un autre « statut ». Lorsque je suis retourné en Europe, et notamment en Corse, j’ai vu des choses que je n’avais alors jamais vues. Sans mon séjour au Japon, une œuvre comme La Mer n’aurait sans doute pas pu voir le jour. C’est à nouveau par le biais de l’« autre » que je suis parvenu à mieux me comprendre. À une époque marquée par le repli sur soi et la montée des nationalismes, il est important pour moi, politiquement et philosophiquement, de reconnaître que c’est l’autre qui nous apprend à nous découvrir.
Est-ce cela que vous recherchez dans le voyage ?
Le voyage nourrit mon œuvre, parce qu’il permet en effet la rencontre de l’autre, que ce soit l’être humain ou le pays, et cette rencontre est souvent différente de ce que l’on avait imaginé. Le voyage nous oblige à tout réapprendre et à réinventer. Lorsque je me rends au Proche-Orient ou en Asie, je découvre de nouveaux systèmes de pensée. Cela me ramène aussi à ma géographie artistique et à mes créations, destinées à un milieu parisien, ou en tout cas occidental.

Vue de l’exposition « Ange Leccia. Je veux ce que je veux », Frac Corsica, Corte, 2023; au premier plan : Lunes, 2019, globes lumineux, Corte, collection Frac Corsica. Photo Léa Eouzan-Pieri
En 2001, vous créez le Pavillon Neuflize OBC, résidence d’artistes et laboratoire de création du Palais de Tokyo, à Paris, et le dirigez jusqu’à sa fermeture en 2017.
J’ai proposé le projet du Pavillon au ministère de la Culture qui préparait alors l’ouverture du Palais de Tokyo. Je voulais tirer les conséquences de mes séjours à la Villa Médicis et à la Villa Kujoyama, et montrer l’importance de rassembler des artistes afin qu’ils confrontent leurs manières d’aborder un sujet. L’un fera un film, l’autre tricotera un pull, un dernier utilisera simplement une tache de peinture. Ce qui m’intéressait était de les observer débattre sur leurs approches et de faire connaître ainsi la multiplicité potentielle des langages pour dire une même chose. Durant ces dix-sept années à la tête du Pavillon, j’ai eu la chance d’accompagner professionnellement de nombreux jeunes artistes, comme Apichatpong Weerasethakul, lequel a ensuite reçu la Palme d’or à Cannes [avec Oncle Boonmee en 2010].
Vous êtes relativement jeune lorsque vous devenez, en 1985, professeur à l’École supérieure d’art de Grenoble. La transmission a-t-elle toujours été une envie ?
J’ai moi-même eu des professeurs extraordinaires qui m’ont transmis un savoir et une curiosité. Il me paraissait évident de me placer à mon tour dans la position de celui qui transmet, mais je n’ai jamais voulu établir de relation de maître à élève. Je me trouvais simplement dans une situation que je ne pouvais absolument pas garder pour moi et que je me devais de partager. À Grenoble, j’ai accompagné toute une génération d’artistes : Philippe Parreno, Véronique Joumard, Pierre Joseph, Christelle Lheureux ou encore Dominique Gonzalez-Foerster, avec laquelle je collabore régulièrement depuis. C’était une autre manière d’enseigner. J’ai par exemple emmené Philippe Parreno au cinéma pour voir Le Mépris de Jean-Luc Godard. J’ai aussi créé un cours, avec Dominique Gonzalez-Foerster qui aimait beaucoup la musique, sur le thème du Top 50.
Précisément, Dominique Gonzalez-Foerster et vous avez récemment réalisé un documentaire sur le chanteur Christophe. Vous collaborez quant à vous depuis cinq ans avec le musicien Perez. Quelle place tient la musique dans votre œuvre ?
Je vais justement participer à un projet à la Cité de la musique [à Paris] sur l’importance de la musique dite « populaire ». Comment la musique de tous les jours peut-elle, au même titre que le ready-made, avoir un rôle dans notre façon de faire des œuvres ? Comment faire basculer une musique que l’on écoute dans son intimité, ou un morceau partagé par un très grand nombre, vers un statut d’œuvre d’art ?Il est important dans l’art de ne pas cloisonner les genres.
Aujourd’hui, quel conseil donneriez-vous aux jeunes générations d’artistes ?
Qu’ils n’aillent pas chercher très loin. Souvent, on pense qu’il faut se mettre dans tous ses états ou faire trois fois le tour du monde pour le comprendre, mais finalement la réponse est à côté. Il faut faire l’effort de regarder en soi, ou d’apprendre à regarder, pour comprendre que les choses importantes sont juste devant nous.
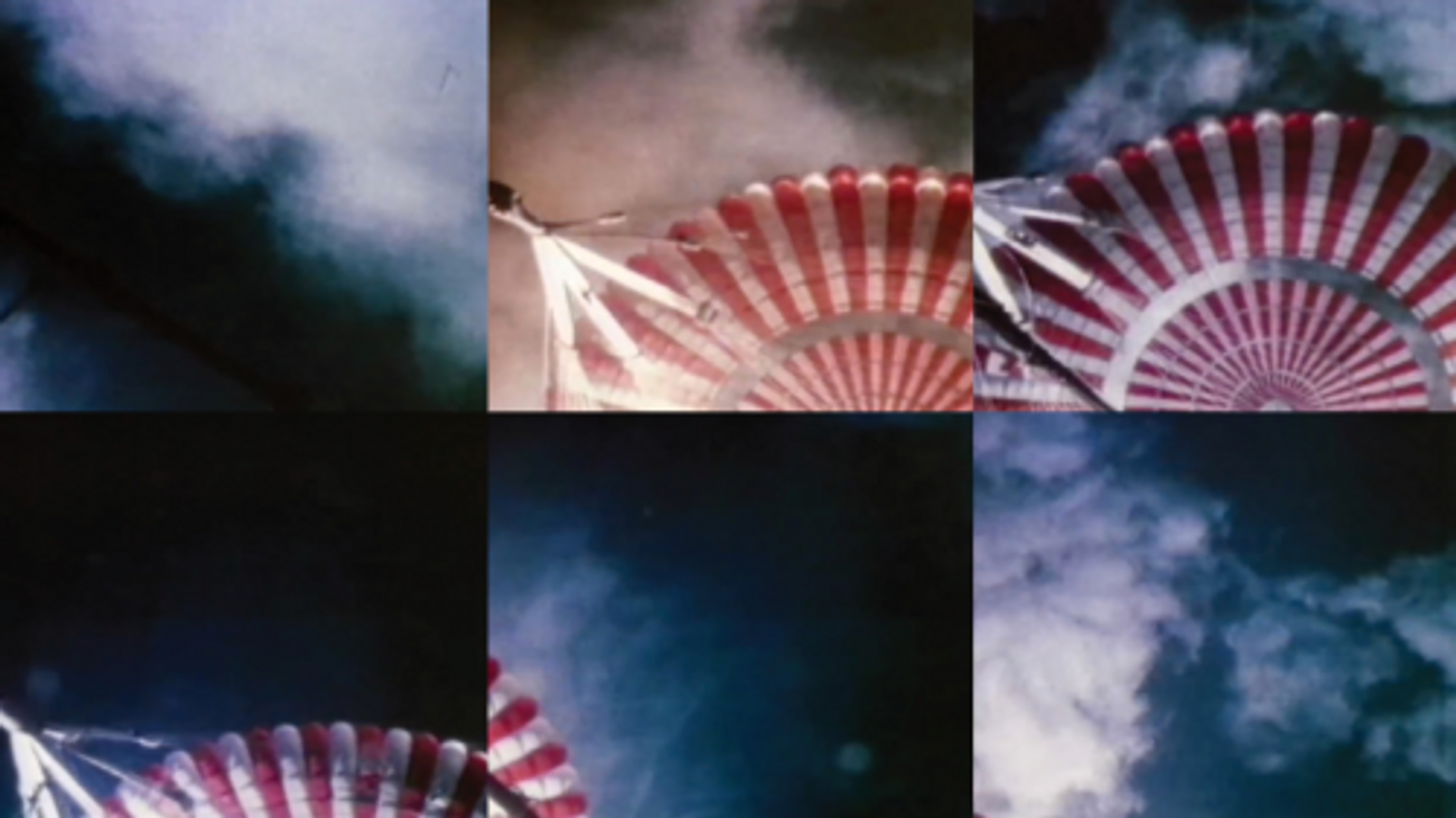
Ange Leccia, Space Oddity, 2019, vidéo HD. Courtesy de l’artiste et de Jousse Entreprise, Paris
Dans les années1980, vous avez accompagné plusieurs projets du ministère de la Culture de Jack Lang. Comment se sont déroulés ces échanges ?
Ni Jack Lang ni son ministère ne cherchaient d’artistes officiels. Au contraire, ils voulaient être au plus près de la création. Ils contactaient les créateurs de l’époque pour leur demander conseil. Je trouvais cela très professionnel, et l’on n’était pas dans ce cas de figure où le ministère donne des indications. À l’inverse, les artistes étaient invités à des comités de réflexion et participaient aux prises de décision. C’est ainsi que je me suis retrouvé plusieurs fois en dialogue ou en accompagnement de projets soutenus par Jack Lang.
Avez-vous l’impression que cette approche s’est perdue aujourd’hui ?
Les fonctionnements actuels sont différents, et parfois le côté administratif prend le dessus; on perd la notion de terrain. Il est pourtant essentiel, à mes yeux, que les artistes prennent part aux décisions.
Vous êtes à l’origine de plusieurs centres d’art dans votre région natale, la Corse.
En effet, dans les années 1980, Jack Lang m’avait interpellé sur le fait que la Corse était la seule région à ne pas avoir de Frac. J’ai donc, à sa demande, rencontré des élus afin de leur faire comprendre l’importance, pour de jeunes créateurs ou même des scolaires, d’être en contact avec les réalités d’une œuvre d’art contemporaine. Ainsi a-t-on a pu faire naître le Frac Corsica, qui a ouvert en 1986. Ensuite, dans le milieu rural du petit village d’Oletta, en Haute-Corse, j’ai créé la fondation Casa Conti*2, un lieu dédié à la jeune création, où nous avons mis en place une résidence.
Vous êtes actuellement au Japon. Qu’y préparez-vous ?
Je présente mon projet (D’)Après Monet à l’Artizon Museum, à Tokyo, que j’ai montré au musée de l’Orangerie [à Paris], en 2022*3. Je l’avais conçu à l’invitation de Cécile Debray qui dirigeait alors l’institution. J’ai filmé les jardins de Giverny avec une vieille caméra de la fin des années1980. La texture particulière qu’elle amenait m’intéressait parce qu’elle offrait une similitude avec Les Nymphéas de Claude Monet. Je prépare également une exposition au centre d’art Hiroshima Art Document. Ensuite, Dominique Gonzalez-Foerster et moi irons en Corée du Sud pour un film sur lequel nous travaillons.
En conclusion, pourriez-vous nous raconter un souvenir artistique fort ?
D’abord, lorsque, lycéen, j’ai vu pour la première fois Zabriskie Point [1970] de Michelangelo Antonioni. Ce film a été déterminant dans ma vocation d’artiste. Puis il y a eu ma visite du Stedelijk Museum, à Amsterdam, où j’ai découvert les œuvres de Piet Mondrian, que je connaissais à travers des reproductions dans lesquelles tout apparaissait lisse. Je me suis retrouvé à dix centimètres de ses toiles et j’ai vu les coups de pinceau, la marque du geste de l’artiste. Je trouvais jusqu’alors ses œuvres très froides; là, j’ai compris qu’il y avait un être humain derrière. Cela m’a beaucoup ému.
-
*1 « Ange Leccia. Je veux ce que je veux », 1er juillet-21 octobre 2023, Frac Corsica, La Citadelle, 20250 Corte.
*2 Ange Leccia y a exposé pour la première fois du 2 juillet au 29 octobre 2023.
*3 « Ange Leccia. (D’)Après Monet », 2 mars-5 septembre 2022, musée de l’Orangerie, place de la Concorde, 75001 Paris.


