Durant toute la préparation de l’exposition, l’ambition des deux commissaires, Charlotte Barat-Mabille et Pierre Wat, a été de revenir à l’œuvre de Nicolas de Staël (1914-1955) en mettant à distance le mythe – celui d’un homme aussi séduisant qu’ombrageux, mort de désespoir. Exilé de Russie à l’âge de 3 ans, bientôt orphelin de père et de mère, Nicolas de Staël est élevé par un couple de tuteurs qui s’oppose au double désir qui l’anime : peindre et voyager. Déterminé, il s’inscrit néanmoins à l’Académie des beaux- arts de Saint-Gilles (Bruxelles) et à l’Académie royale des beaux-arts de Bruxelles, avant de parcourir, jusqu’à la fin de sa vie, l’Europe ou le Maroc. Après la Seconde Guerre mondiale, il suscite l’attention des marchands et des critiques, et rencontre ses premiers succès en France, puis aux États-Unis. Jusqu’en 1955, il s’emploie avec une énergie peu commune à la peinture. Mais son suicide à 41 ans nourrit sa légende au détriment parfois de la connaissance de son œuvre.
Les commissaires, pour leurs recherches, ont bénéficié de plusieurs avancées récentes. Depuis la précédente rétrospective (organisée au Centre Pompidou, à Paris, il y a deux décennies), la publication d’un important ensemble de lettres (en 2014), la réédition du catalogue raisonné mis à jour (2021), sans oublier une série d’expositions thématiques éclairant des aspects précis ou méconnus de sa pratique, ont permis de porter un regard nouveau sur une trajectoire aussi dense que fulgurante. Au reste, Charlotte Barat-Mabille et Pierre Wat ont pu travailler en étroite collaboration avec le Comité Nicolas de Staël, dont les missions principales sont la promotion et la diffusion du savoir sur le peintre. Forts de ces atouts, ils ont choisi de rendre hommage, à travers un parcours chronologique, à la composante fondamentalement expérimentale de cet artiste, mû, dès les années 1930, par la quête incessante de la juste traduction en peinture des images du monde. Ainsi les commissaires ont-ils sélectionné quelque 200 œuvres, notamment issues de collections particulières (Nicolas de Staël étant peu présent dans les collections publiques nationales), dont un quart n’a jamais été exposé dans un musée français. Parmi cette sélection, on remarque la présence de très nombreux dessins, d’une grande importance pour l’artiste et qui constituent une des découvertes les plus stimulantes de l’exposition.
UN CHERCHEUR INSATIABLE
Le parcours s’ouvre sur une première section, « Le Voyage d’un peintre (1934-1947) », consacrée aux années de formation du jeune Nicolas de Staël. En dépit de son goût pour la peinture hollandaise, il cherche très vite la lumière du Sud à laquelle il ne cessera de revenir. Après un séjour dans le Midi, où il compose des vues synthétiques à l’encre de Chine et à l’aquarelle, il se rend au Maroc, en 1936-1937, sur les traces d’Eugène Delacroix. De retour en France, des carnets emplis de motifs orientalistes dans ses bagages, il dessine des marines et des portraits de sa compagne, la peintre Jeannine Guillou. C’est à ses côtés qu’il s’installe en 1940 à Nice, où il rencontre Sonia Delaunay, Marie Raymond, Christine Boumeester, Henri Goetz ou encore Alberto Magnelli avec lequel il se lie d’amitié. L’année 1942 marque un tournant : les premières incursions du peintre dans la non-figuration ouvrent la voie à de grandes compositions sombres et enchevêtrées (Composition en noir, 1946). La matière picturale devient pâteuse avec des lignes de force au grand dynamisme (De la danse, 1946-1947).
La section suivante, intitulée « Rue Gauguet (1948-1949) » du nom de la rue parisienne où se situe désormais son vaste atelier, révèle avec clarté combien ses recherches esthétiques sont liées au lieu où il peint. Dans cet espace conçu par un élève de Robert Mallet-Stevens, doté d’une grande verrière et d’une hauteur sous plafond de 8 mètres, il voit sa palette s’éclaircir considérablement. Ses compositions se structurent davantage pour donner naissance à des imbrications de triangles et de polygones monochromes (Composition, 1949 ; Composition grise, 1949).
Dans la suite, les parties « Condensation (1950) » et « Fragmentation (1951) » sont symptomatiques des recherches perpétuelles menées avec fièvre par Nicolas de Staël, peu enclin à se contenter longtemps d’une trouvaille. Alors que son œuvre attire l’attention des critiques et des marchands, l’artiste articule des formes colorées pareilles à des masses (Grande Composition bleue, 1950-1951). Il peint par couches successives, offrant une gamme chromatique de plus en plus subtile, et alterne les formats, animé par la volonté de ne pas se répéter. On découvre aussi ses dessins au feutre dans lesquels les lignes brisées, parfois courbes (Composition, 1950), signalent une vision tranchante.
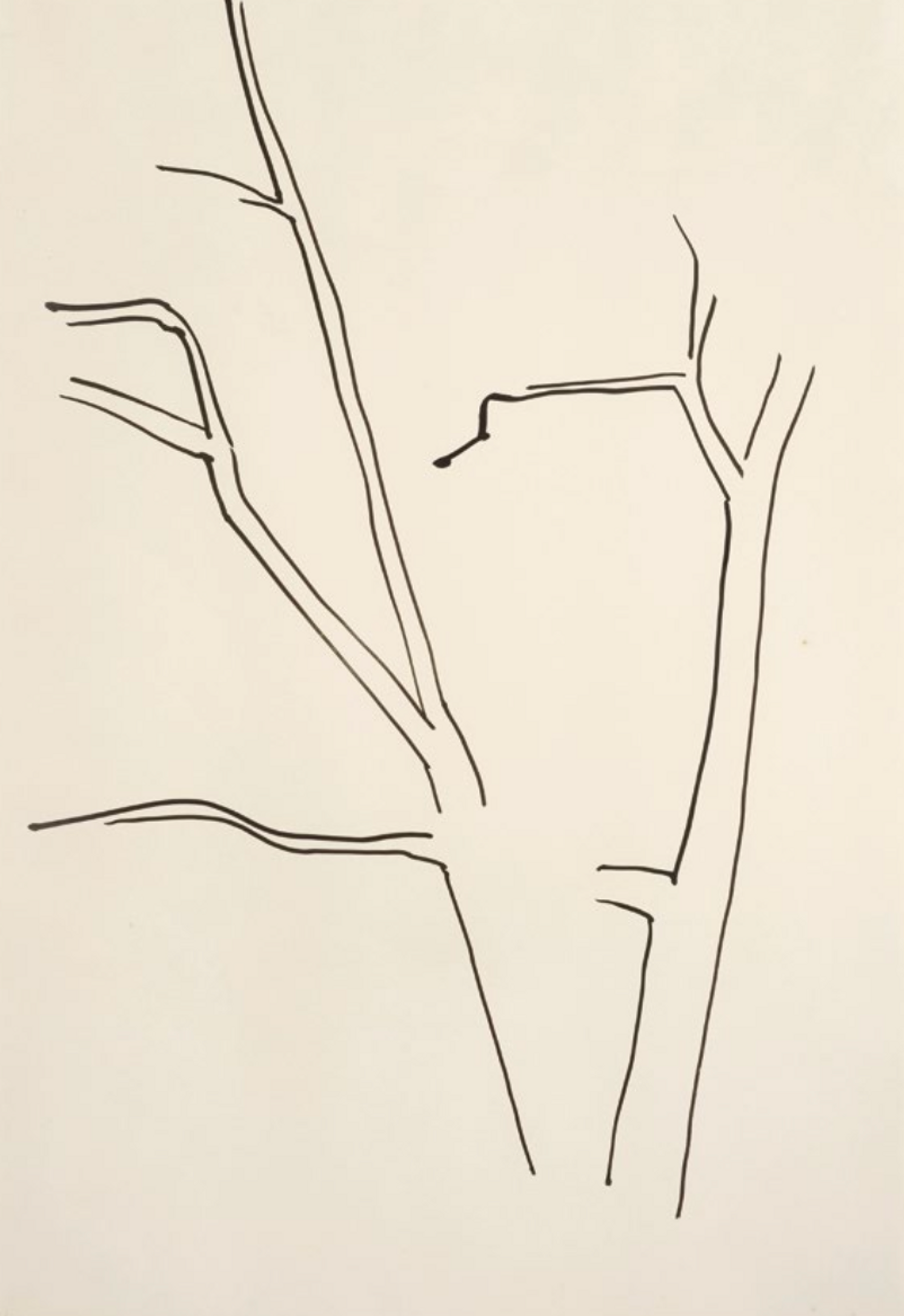
Nicolas de Staël, Arbres, 1954, pinceau et encre de Chine sur papier, collection particulière. Photo : Jean-Louis Losi
Une même volonté de renouvellement s’exprime quelques mois plus tard lorsque Nicolas de Staël décompose les formes en une multitude de tesselles. Le domaine des arts graphiques, longtemps méprisé par les historiens et le public, se révèle également plein de surprises. On ne saurait ainsi négliger la vitrine dédiée aux gravures sur bois pour les Poèmes (1951) de son ami René Char, plus puissantes que certains des tableaux accrochés à proximité (Fleurs grises, 1952). À la même époque, le lien avec le réel – jamais rompu selon l’artiste qui, tout au long de sa carrière, rejette le dogmatisme de l’abstraction – se fait plus lisible.
DÉFAIRE POUR RÉINVENTER
La suite de l’exposition porte sur deux thématiques primordiales pour le peintre : le paysage et le spectacle (1952-1953). Pendant un an, il peint sur le motif, autour de Paris, dans le Lavandou, en Normandie. De ses recherches précédentes, il conserve la fragmentation des volumes qu’il traite désormais de manière architecturée (Gentilly, 1952 ; Les Toits, 1952 ; Étude de paysage, 1952). Un match de football auquel il assiste à Paris introduit un agencement dynamique des formes colorées (Parc des Princes, 1952 ; Le Concert, 1953). Défaire pour mieux réinventer. Le leitmotiv de Nicolas de Staël se fait toujours plus audible à mesure qu’il déploie son œuvre.
Les trois salles suivantes, « L’atelier du Sud (1953) », « Lumières (1953) » et « Sicile (1953- 1954) » montrent comment, après avoir exploré le réel depuis son nouvel atelier de Lagnes, près d’Avignon (Table rose, 1953), il revient au paysage, bouleversé par la lumière aveuglante du Sud (Le Soleil, 1953). L’accrochage imaginé autour du voyage en Sicile qu’effectue l’artiste à l’été 1953 est une grande réussite : aux paysages extraordinairement lumineux qu’il conçoit de mémoire à son retour en France font face les dessins réalisés sur place, dont l’épure, débarrassée de la couleur et de la matière, sidère. Dans la section suivante, « Sur la route (1954) », ce sont encore les dessins qui frappent par leur radicalité. Ses poires et ses arbres semblent annoncer certaines œuvres de l’Américain Ellsworth Kelly exécutées quelques années plus tard. Des études de tête prouvent, si besoin en est, les qualités de synthèse et d’expressivité du peintre.
La dernière partie, « Antibes (1954-1955) », est dédiée à ce qui s’avérera être les dernières expérimentations du peintre. Sur des fonds sombres dominés de tons bleu-gris, Nicolas de Staël peint de nombreuses natures mortes, à l’exemple du Saladier (1954) ou de Nature morte en gris (1954), dans lesquelles il délaisse la fragmentation au profit d’une fluidité nouvelle, obtenue notamment grâce à la térébenthine. Des mouettes s’envolent vers l’horizon. «Je n’ai pas la force de parachever mes tableaux », écrit-il dans une ultime lettre à son marchand, avant de se jeter du toit-terrasse de son atelier, face à la mer Méditerranée.
« Nicolas de Staël », 15 septembre 2023-21 janvier 2024, musée d’Art moderne de Paris, 11, avenue du Président-Wilson, 75016 Paris.


